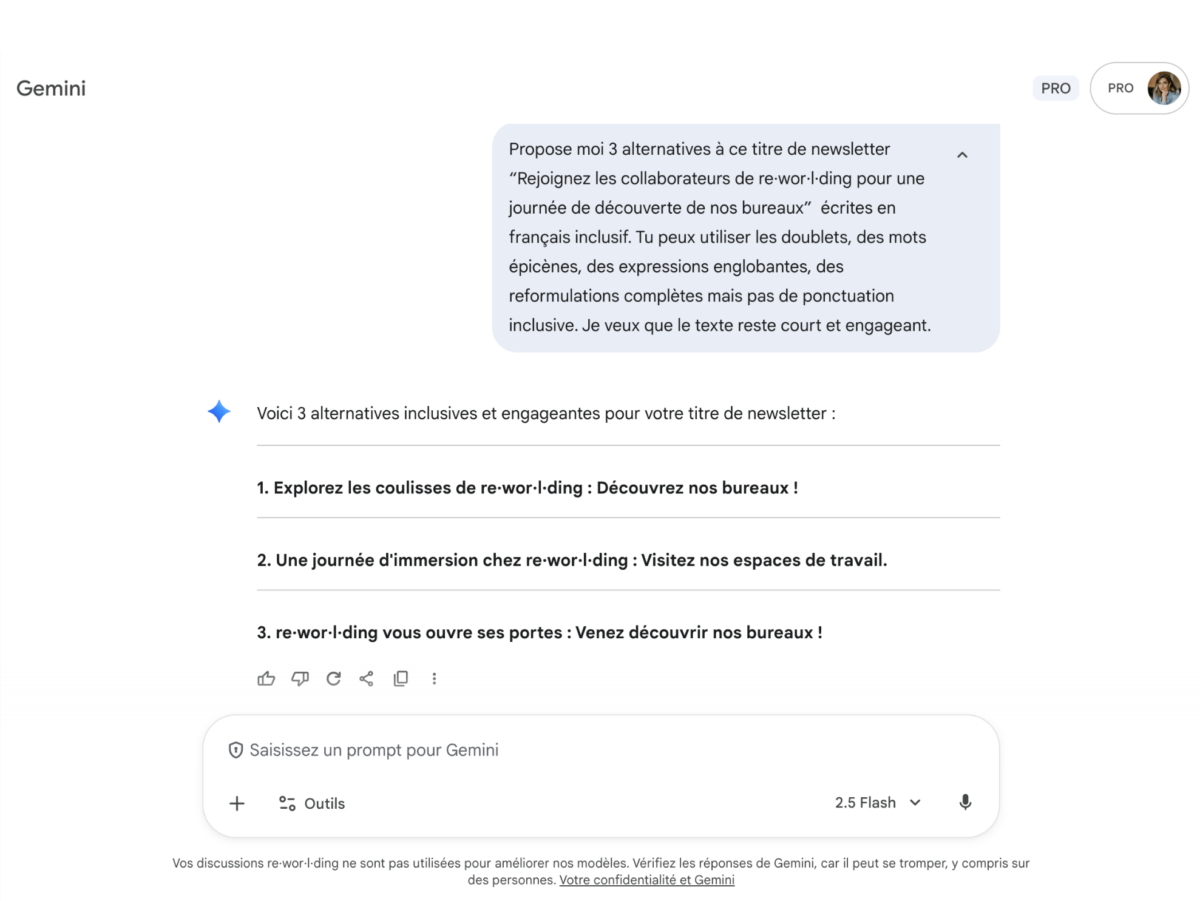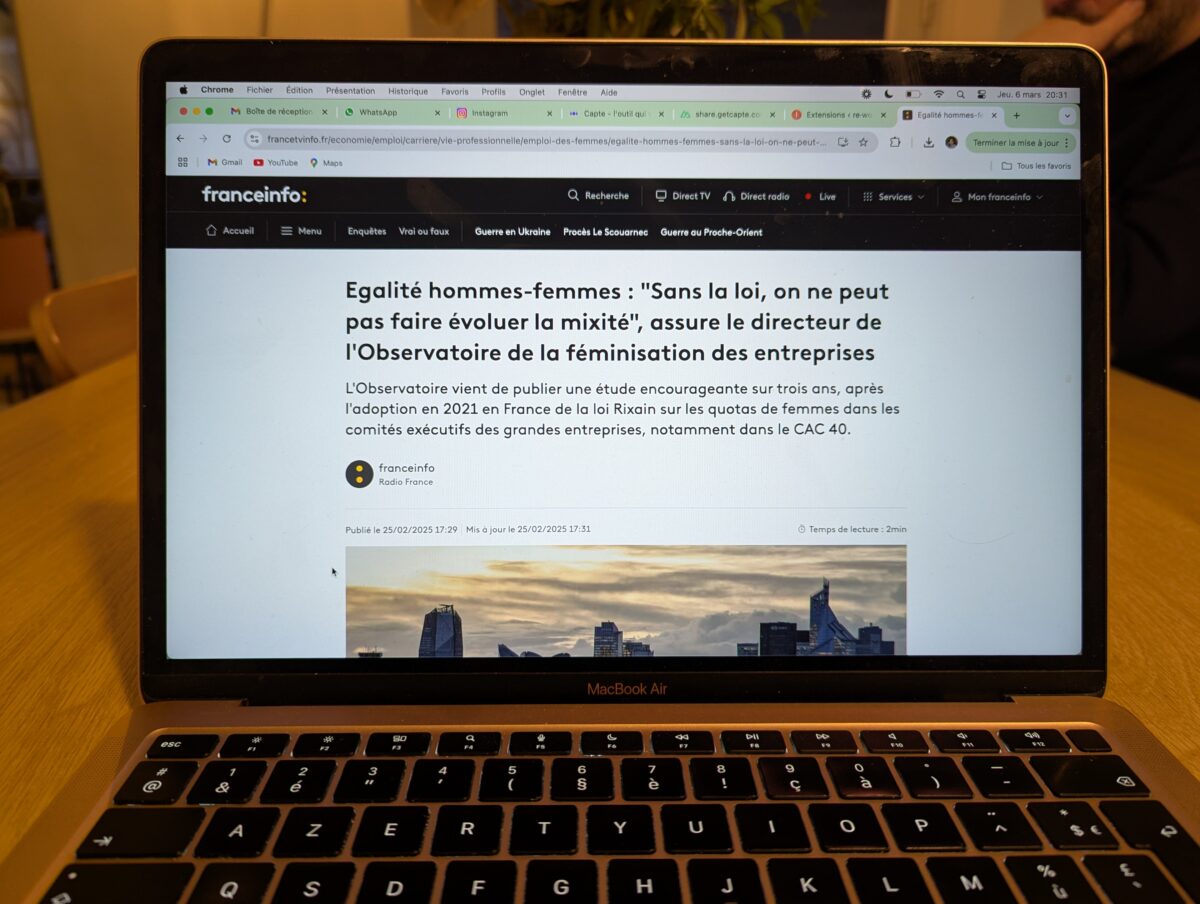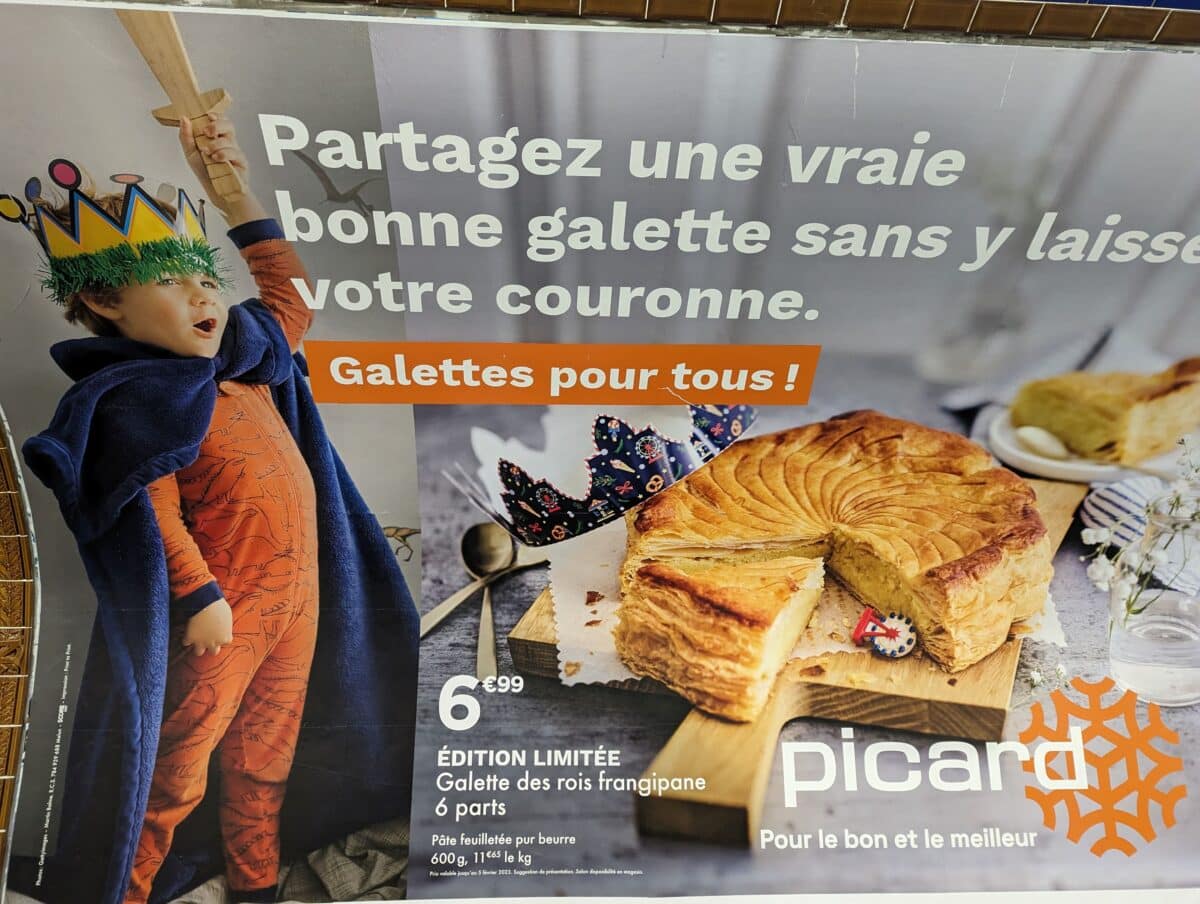Quel est le point commun entre l’expression « les rats quittent le navire », le néologisme « girlcott » et l’insulte « sales connes » ? Réponse : ces mots et expressions ont fait l’actualité ces dernières semaines, voire ont carrément créer la polémique. Alors que l’année 2025 touche à sa fin, j’ai pensé que c’était une bonne occasion pour regarder […]