J’aime bien l’exercice des rétrospectives, surtout celles qui permettent de se replonger dans les lectures faites dans l’année écoulée et de prendre conscience de tous ces livres lus (et, il faut être franche, de tout ce qu’on n’en a pas retenu).
L’année dernière, j’avais déjà partagé une liste des 10 livres sur le langage inclusif en 2021 : cette liste est pour moi le socle fondateur. Cette année, j’ai élargi le champ des possibles avec des livres de différents registres (essais bien sûr mais aussi BD ou romans) qui parlent de plus ou moins près du langage inclusif mais qui ont tous, d’une manière ou d’une autre, nourri mes réflexions, et pour certains inspiré des articles écrits ici.
Je vous propose donc cette année une rétrospective sur le mode listicle des livres que j’ai aimés et qui m’on appris quelque chose pour parler en féministe.
5 livres sur les pensées féministes

Futur·es, Comment le féminisme peut sauver le monde, Lauren Bastide, Allary Editions : le nouvel essai de Lauren Bastide est un condensé très accessible, souvent drôle et justement énervé, de l’état des théories féministes, notamment les plus récentes et radicales (dans le sens bon du terme) autour des identités de genre, des relations amoureuses, des violences subies par les corps, de la question du care et de l’écoféminisme. Elle mentionne rapidement le débat sur l’écriture inclusive (et coucou le point médian sur la couverture, certainement le premier que je vois en librairie et que certain·es n’auront peut-être même pas identifié tant il est gros !) mais ce n’est pas le coeur de cet essai qui propose, dans la même veine qu’une Titiou Lecoq avec ses livres sur Les grands oubliées ou Le couple et l’argent (que je recommande aussi d’ailleurs), un ouvrage à la fois de synthèse hyper documentée mais aussi de réflexion personnelle sur les sujets qui nous mobilisent aujourd’hui.
Sortir de l’hétérosexualité, Juliet Drouar, Binge Audio Editions : « et si nous étions des personnes plutôt que des femmes ou des hommes ? « Ce qui m’a le plus éclairé à la lecture de ce livre est la proposition d’arrêter de considérer le sexisme uniquement comme une domination subie par les femmes mais par toutes les personnes sexisées, c’est-à-dire aussi les personnes intersexes, trans, bi, gay, lesbiennes. Le mot sexisé·e a d’ailleurs fortement résonner avec une réflexion que j’avais par ailleurs sur la voix passive et je cite Juliet Drouar dans l’article Pourquoi je dis : une personne racisée, ou de l’usage du passif dans le vocabulaire des discriminations. Un livre parfois théorique qui s’adresse, pour moi, à des personnes déjà familières du vocabulaire politique des militant·es féministes.
Tout le monde peut être féministe, bell hooks, éditions divergences : première lecture de bell hooks pour moi avec ce livre qui se veut une « introduction courte et accessible à la théorie féministe » répondant « sans jargon idéologique à la question : qu’est-ce que le féminisme ? ». En effet, un livre à mettre en toutes les mains de personnes souhaitant une première lecture sur les enjeux du féminisme. J’ai été particulièrement sensible au chapitre « L’éducation féministe de la conscience critique » qui plaide notamment pour le développement de ressources accessibles pour que chacun·e, quelque soit son âge ou son expérience, puisse éveiller sa conscience féministe. Ecrit en 2000 (et traduit en 2020 en français), ce livre précède l’explosion du contenu pédagogique féministe, notamment sur les réseaux sociaux, mais pour moi cet enjeu est toujours d’actualité.
Pour enseigner la pensée et la théorie féministes à tout le monde, nous devons aller au-delà du monde universitaire et même au-delà de l’écrit. Beaucoup de gens n’ont pas les compétences nécessaires pour lire la plupart des livres féministes. Les livres audio, les chansons, la radio et la télévision sont autant de moyens de diffuser le savoir féministe. Et bien sûr, nous avons besoin d’un réseau de télévision féministe, ce qui n’est pas la même chose qu’un réseau de télévision adressé au public féminin. Mobiliser des fonds pour créer un réseau de télévision féministe nous aiderait à répandre la pensée féministe dans le monde entier.
Le corps des femmes, la bataille de l’intime, Camille Froideveaux-Metterie, Points : je suis rentrée par ce livre dans l’oeuvre de cette philosophesse passionnante. Lire ce livre m’a fait réfléchir au mot féminin, un terme que je préfère ne pas trop utiliser car il renvoie souvent à une vision essentialiste où les femmes seraient par nature comme ci ou comme ça (raison pour laquelle je ne dis pas : leadership féminin, par exemple). Mais l’autrice développe dans cet ouvrage et d’autres l’idée « d’un féminisme incarné », c’est -à-dire un féminisme qui reconnaît l’importance de l’expérience vécue d’un corps de femme (cisgenre ou non) comme fondamentalement différente de celle vécue dans un corps d’homme ; le mot féminin pour renvoyer à cette expérience a donc du sens.
Cette approche permet de dépasser l’opposition entre différentialisme biologisant et universalisme constructiviste en proposant de réfléchir le féminin et le masculin non pas comme deux concepts éternels disant ce que sont ou doivent être les femmes et les hommes, mais comme deux types de subjectivité corporelle historiquement et socialement construits qui englobent d’innombrables variations individuelles.
Un féminisme décolonial, François Vergès, La fabrique : un livre que je peux pas dire avoir pris du plaisir à lire car il bouscule, à raison, mon statut de femme blanche hétérosexuelle économiquement privilégiée, mais un livre nécessaire qui questionne les dimensions intersectionnelle et anticapitaliste du féminisme : qu’y a-t-il de féministe pour des femmes comme moi à se libérer des contraintes du foyer en précarisant d’autres femmes, souvent racisées, pour prendre soin de leur maison ou de leurs enfants ?
2 livres sur le militantisme contemporain
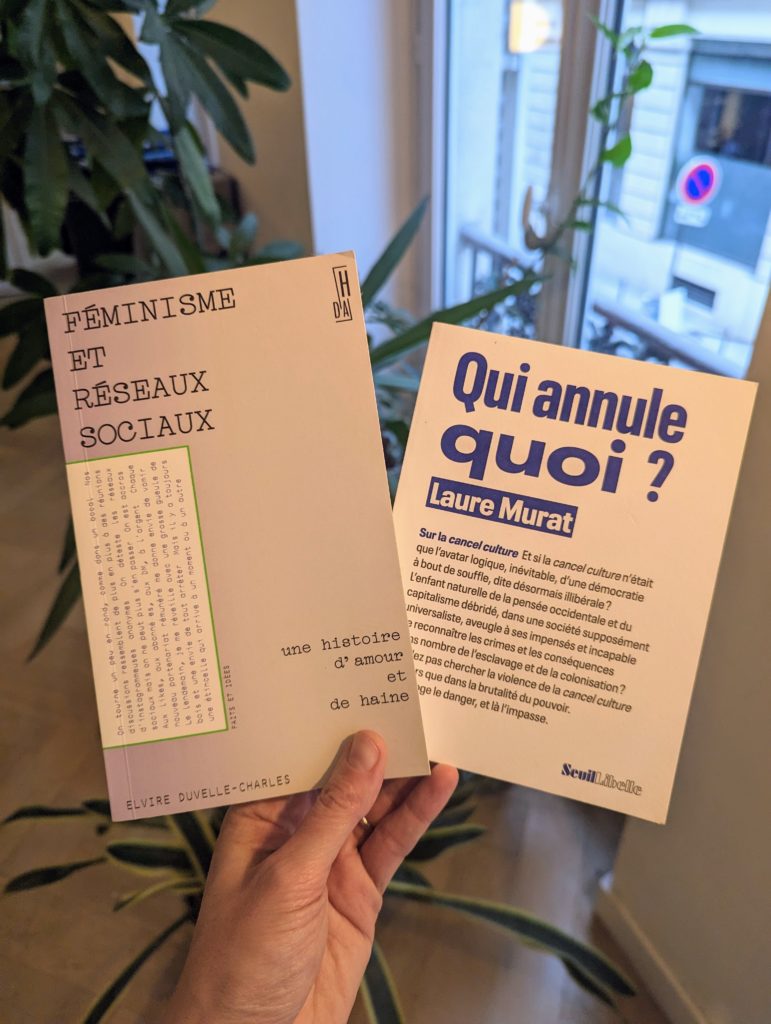
Féminisme et réseaux sociaux, une histoire d’amour et de haine, Elvire Duvelle-Charles, éditions Hors d’atteinte
Qui annule quoi ?, Laure Murat, Seuil Libelle
Elvire Duvelle-Charles, militante féministe passée par les Femen et créatrice de @ClitRevolution, démontre dans cet essai le potentiel libérateur des réseaux sociaux dans la lutte féministe aussi bien que leur impact néfaste sur la fatigue militante ou la sécurité des féministes en ligne, harcelées et menacées. Elle y parle, notamment dans le chapitre « quand les call out et les dogpiles se retournent contre nous » de l’importance d’employer un langage précis pour lutter contre les discriminations et de la pression exercée sur toutes celles et tous ceux qui s’expriment à le faire « parfaitement ».
Alors que les call-out nous servaient à dénoncer des personnes ayant du pouvoir dont les comportements étaient problématiques, les mauvaises pratiques des entreprises ou des publicités sexistes, cette pratique s’est progressivement retournée contre les militantes elles-mêmes. Scrutées par leurs semblables, elles se retrouvent de plus en plus pointées du doigt pour des mots maladroits ou des actes qui ne sont pas en totale cohérence avec leur combat (…). L’essor que le féminisme a pris ses dernières années s’est accompagné d’une intransigeance sur les discours féministes et d’une course à la pureté militante vertigineuse.
A la pratique du call out (interpellation publique, souvent agressive), elle préfère celle du call in, un genre de call out bienveillant, fait en privé, de manière constructive. J’ai retrouvé cette expression dans un article du New York Time : What if Instead of Calling People Out, We Called Them In? On y décrit la pratique de Loretta J. Ross, professeuse au Smith college qui « challenge la call out culture » :
« Les femmes sont des étudiantes dans une classe enseignée par Loretta J. Ross, professeuse invitée à Smith College, qui les met au défi d’identifier les caractéristiques et les limites de la culture du call out : l’acte de mettre en cause publiquement une autre personne pour un comportement considéré comme inacceptable. On peut décrire le call out comme une sœur de la dénonciation, plutôt problématique, et une des nombreuses choses qui peuvent conduire à l’annulation (« cancelling »). « Je mets en question la culture du call out « , a déclaré la professeuse Ross de chez elle à Atlanta, où elle donnait récemment une conférence en direct par Zoom à ses étudiant·es, vêtue d’une muumuu bleue du Ghana. « Je pense que vous pouvez comprendre à quel point le call out peut être toxique. Il éloigne vraiment les gens et les rend craintifs de s’exprimer. »1
What if Instead of Calling People Out, We Called Them In? New York Times, Novembrer 2020
Laure Murat, dans Qui annule quoi ? propose d’expliquer par l’exemple (en l’occurrence celui des déboulonnages des statues dans une pespective décoloniale) les enjeux de la cancel culture, et propose d’ailleurs « un autre nom, plus proche de la réalité quelle produit : accountability culture (culture de la responsabilité) ou encore pensée woke (éveillée) ». Je recommande ce livre très court (moins de 40 pages) qui permet de cultiver son esprit critique sur un sujet où les débats actuels manquent souvent de nuance.
6 livres sur la représentation des femmes dans l’art, l’histoire, les médias et la culture

Une place, Réflexion sur la présence des femmes dans l’histoire de l’art, écrit par Eva Kirilof et dessiné par Mathilde Lemiesle, Les insolentes
Vieille fille, Marie Kock, Cahiers libres La Découverte
Féminismes et pop culture, Jennifer Padjemi, Stock
Mythes & meufs, Blanche Sabbah, Mâtin Dargaud
La revanche des autrices, Julien Marsay, Payot
Défaire le discours sexiste dans les médias, Rose Lamy, JC Lattès
Parler en féministe, c’est aussi pour moi être capable de féminiser son discours pas seulement dans son vocabulaire mais aussi dans les noms que l’on cite, et nous savons bien que le nom des femmes qui auraient du rester célèbres pour leurs écrits, leurs recherches ou leur art, ne sont pas toujours arrivés jusqu’à nous. Ce que font des livres comme La revanche des autrices ou Une place c’est non seulement redonner de l’espace à des noms de femmes oubliées (chacun contient des notices biographiques sur des autrices ou des femmes peintres) mais aussi (et surtout) expliquer les mécanismes qui ont conduit à leur effacement de l’histoire (également le sujet du livre de Titiou Lecoq cité plus haut, Les grandes oubliées). Ce qui fait dire à Eva Kirilof dans Une place :
J’ai beaucoup de mal avec le terme « oubliées » quand on parle de femmes artistes, car il y a quelques chose de l’ordre de la passivité. Il ne s’agit pas (…) d’une défaillance de notre mémoire collective, mais d’un système bien huilé qui a longtemps refusé aux femmes les possibilités matérielles mais également symboliques d’accéder au monde de l’art.
Pour sortir de la passivité et mettre en avant le système d’oppression, je préfère donc le terme invisibilisées (sur le modèle de tous les mots en -iser utilisés pour parler des discriminations dont je parle ici). Un livre que j’aurais aussi pu référencer dans mon article consacré aux épicènes : Femmes artistes, artistes femmes : les épicènes, faux amis du langage inclusif ?
Et puis parfois on se souvient de leurs noms, mais l’histoire qu’on se raconte est une interprétation discutable : dans Mythes et Meufs, Blanche Sabbah passe ainsi au crible une vingtaine de mythes tournant autour de personnages féminins, comme Jeanne d’Arc, Méduse, La Petite Sirène ou Pocahontas. Nombreuses sont ces femmes qui ont inspiré des productions culturelles modernes (notamment beaucoup de dessins animés). Dans ce livre alternent pour chaque mythe quelques planches de BD puis une page de texte revenant plus en détail sur leur interprétation. Un livre qu’on peut donc mettre aussi dans les mains de plus jeunes lecteurs et lectrices grâce à ce double niveau et aux nombreuses références actuelles qu’il contient.
Parmi les mythes modernes, celui de la Vieille Fille, détricoté par Marie Kock dans un essai très personnel où elle revient sur ce qui fait qu’une femme célibataire et indépendante est nécessairement reléguée au statut de fillette immature, d’adulte incomplète ou de vieille inutile.
J’ai relu plusieurs fois ce passage où l’autrice explique ne pas refuser le principe de l’amour romantique mais ne pas être prête à tout accepter, en redéfinissant au passage la notion de « besoin » :
Moi, je n’ai pas envie de demander moins. De renier mes standards élevés, presque impossibles à atteindre. Parce que sinon, à quoi ça sert ? En vivant seule longtemps, j’ai appris à être ma meilleure compagne. A être indépendante, à me respecter, à m’aimer. Je ne suis plus dans l’attente d’être complétée. Je suis déjà entière. C’est donc ça mon standard : quelqu’un dont je n’aurais pas besoin.
Mais au-delà des mythes et des figures, la représentation des femmes n’est pas uniquement une question de place, mais aussi une question de traitement : je suis allée voir du côté de la pop culture avec Jennifer Padjemi et de celui des médias avec Rose Lamy. Cette dernière, aussi créatrice du compte @Préparez-vous pour la bagarre, dresse le tableau des modes d’écriture journalistique qui contribuent à maintenir ou renforcer des discours sexistes dans les médias avec un focus sur le traitement des violences sexistes et sexuelles (à l’image du malheureusement fameux « une femme se fait violer » dont je parle ici). On y parle donc beaucoup de vocabulaire et de précision du langage, avec de nombreux exemples très concrets à l’appui : un travail inédit et nécessaire que je recommande vivement. Jennifer Padjemi démontre quant à elle comment la pop culture et ses objets (surtout les séries et la musique) offrent des terrains de jeu presque infinis pour donner à voir d’autres représentations des femmes, de leurs corps, de leur santé mentale, mais aussi des hommes et avec un accent sur les personnes LGBTQIA+. C’est un livre qui démontre aussi le chemin qu’il reste à parcourir, à grands coups d’examples décortiqués et analysés de contenus culturels qui sont autant d’idées de séries à regarder, de livres à lire ou de chansons à écouter.
2 romans bouleversants
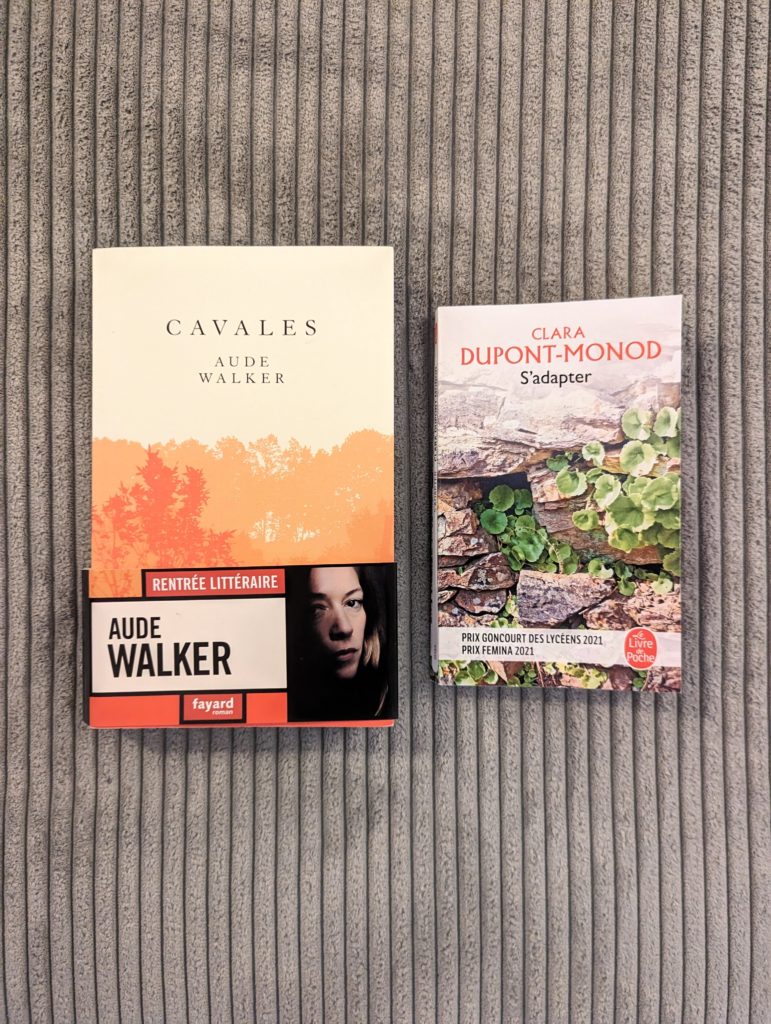
Cavales, Aude Walker, Fayard
S’adapter, Clara Dupont-Monod, Le livre de poche
Il est rare que des livres parviennent à me faire pleurer mais ces deux-là on réussi. J’ai acheté le premier, Cavales, en écoutant une chronique de France Inter qui mentionnait ce livre rédigé en écriture inclusive. Sans savoir quel était le sujet du livre, je l’ai acheté par curiosité car en littérature, les auteurs et autrices qui écrivent en inclusif sont encore rares (on peut citer l’exemple de Martin Winckler). Je dois avouer que ce n’est pas l’écriture inclusive qui m’a séduite dans ce texte (elle concerne surtout des accords de verbes et ne suit pas la convention d’un usage raisonné du point médian que je pratique) même si évidemment ça m’a fait plaisir. Non, c’est simplement l’histoire, celle de trajectoires de vies un peu (ou très) cassées, qu’on croit comprendre au départ et qui se dévoilent à nous au fil des pages, sur un fond de paysage californien, qui m’a franchement transportée.
Pour S’adapter, c’est en cherchant à lire sur le handicap que je suis tombée sur ce livre, également Goncourt des lycéens (et des lycéennes, s’il vous plaît) où Clara Dupont-Monod retrace, à quelques choses près et en personne concernée, l’histoire de sa famille où est né un enfant handicapé, dans ses mots à elle, inadapté. C’est par le récit fait par les pierres du jardin de la maison cévenol où se déroule l’histoire que l’on apprend à connaître cet enfant par le regard de ses frères et soeur, et c’est tout simplement magnifique. C’est de la beauté et de l’amour que j’ai retenu de ce roman que j’ai envie de faire lire à tout le monde autour de moi. Voici les premiers mots du livre :
Un jour, dans une famille, est né un enfant inadapté. Malgré sa laideur un peu dégradante, ce mot dirait pourtant la réalité d’un corps mou, d’un regard mobile et vide. « Abîmé » serait déplacé, « inachevé » également, tant ces catégories évoquent un objet hors d’usage, bon pour la casse. « Inadapté » suppose précisément que l’enfant existait hors du cadre fonctionnel (une main sert à saisir, des jambes à avancer) et qu’il se tenait, néanmoins, au bord des autres vies, pas complètement intégré à elles mais y prenant part malgré tout, telle l’ombre au coin d’un tableau, à la fois intruse et pourtant volonté du peintre.
2 livres sur la puissance du langage
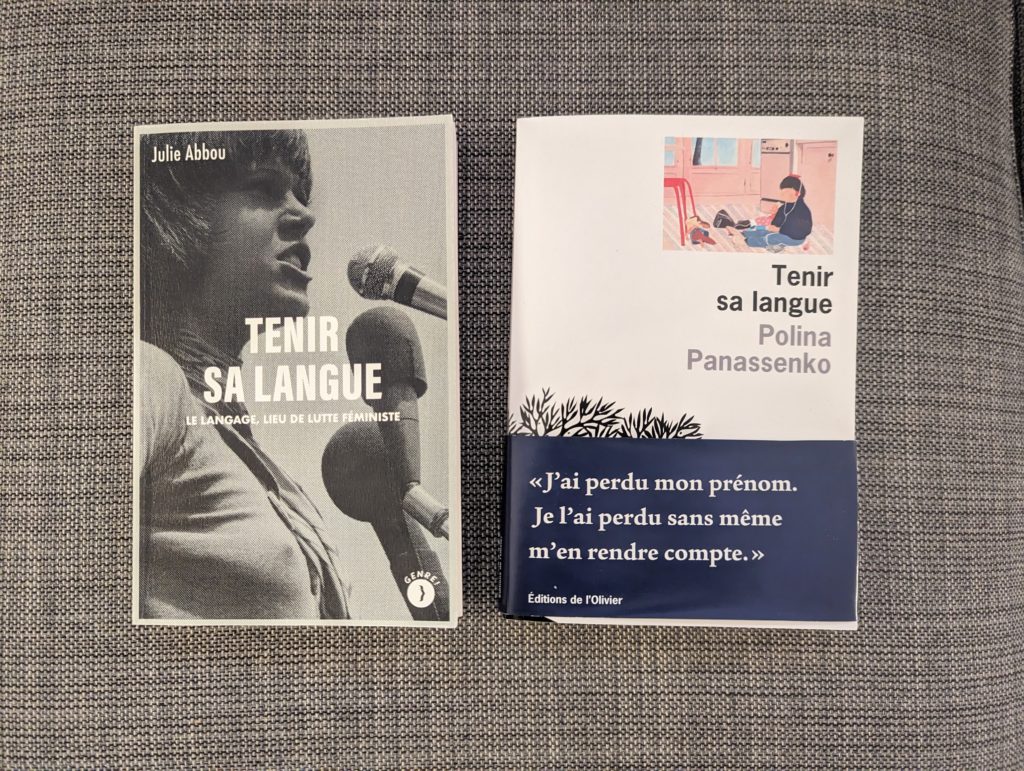
Tenir sa langue, Le langage, lieu de lutte féministe, Julie Abbou
Tenir sa langue, Polina Panassenko, L’Olivier
C’est en cherchant le livre de la linguiste Julie Abbou que je suis tombée sur le roman du même titre de Polina Panassenko. Le roman (Prix Femina des lycéens 2022, et des lycéennes aussi s’il vous plaît !) retrace l’histoire de Pauline, russe naturalisée française qui s’est installée avec sa famille en France dans les années 90 et cherche à se réapproprier, par voie de justice, un élément constitutif de son identité qui lui a été enlevé : son prénom russe, Polina. En racontant son parcours d’immigrée, elle montre comment tenir sa langue est devenue sa stratégie d’intégration : perdre l’accent russe en France, ne pas parler français en Russie. C’est cette idée que notre langue est un puissant vecteur de revendication d’identité et d’une place dans le monde qui unit ses deux livres.
Celui de Julie Abbou est le livre d’une linguiste qui travaille depuis des années sur la question du langage inclusif, ou plus exactement comme elle préfère l’écrire, des pratiques féministes du langage. C’est un essai parfois plus technique mais qui m’a appris beaucoup, notamment sur les origines de l’expression langage inclusif, née aux Etats-Unis alors que certaines Eglises cherchaient à rendre les traductions de la Bible inclusives. J’avoue que je ne l’avais pas vu venir. L’essai est aussi une réflexion critique féroce sur la marchandisation du langage inclusif (aujourd’hui objet de formation dispensées par des agences ou de récupération commerciale dans la publicité) et sur la notion même d’inclusion, qui est, pour l’autrice, « une arnaque » universaliste et pas un outil pertinent pour penser la nécessaire radicalité politique que l’égalité entre les individus requiert. Je ne suis pas d’accord avec certaines des idées qu’elle défend (et je fais partie des personnes qui vendent des formations au langage inclusif) mais j’ai pris beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage d’experte qui remet aussi sur le devant de la scène une émotion fondamentale à ses pratiques du langage en féministe : la joie. Celle de créer de nouveaux mots, de jouer avec les conventions (à la manière d’une Noëmie Grunenwald dans Traduire en féministe/s), de bifurquer avec les mots, de créer, de provoquer, de politiser nos mots. Mais elle reconnaît aussi une émotion que j’ai observée chez de nombreuses personnes hésitantes face au langage inclusif et que j’analyse dans 3 freins à la pratique du langage inclusif : la peur.
L’exploration joyeuse et irrégulière qui consiste à pousser la grammaire à ses confins, la dimension ludique des pratiques féministes sont primordiales. Mais peur linguistique et hygiène verbale font obstacle à ces expérimentations. (…) J’ai moqué tout à l’heure la profusion de guides pour la féminisation et le langage non sexiste. Mais cette profusion répond à un besoin, celui des personnes amené·es à manipuler ces formes et qui, en l’absence de standard fourni par les autorités linguistiques habituelles (Etat, Académie, école, grammaire, etc.) se trouvent perdu·es, se sentent incompétent·es. C’est donc chaque institution, chaque organisme, qui doit bricoler une ligne de conduite, pour ne pas laisser ses locuteur·trices dans le désarroi.
Bonnes lectures !
1 Traduction libre de : The women are students in a class taught by Loretta J. Ross, a visiting professor at Smith College who is challenging them to identify the characteristics, and limits, of call-out culture: the act of publicly shaming another person for behavior deemed unacceptable. Calling out may be described as a sister to dragging, cousin to problematic, and one of the many things that can add up to cancellation.
« I am challenging the call-out culture,” Professor Ross said from her home in Atlanta, where she was lecturing on Zoom to students on a recent evening, in a blue muumuu from Ghana. “I think you can understand how calling out is toxic. It really does alienate people, and makes them fearful of speaking up.”

