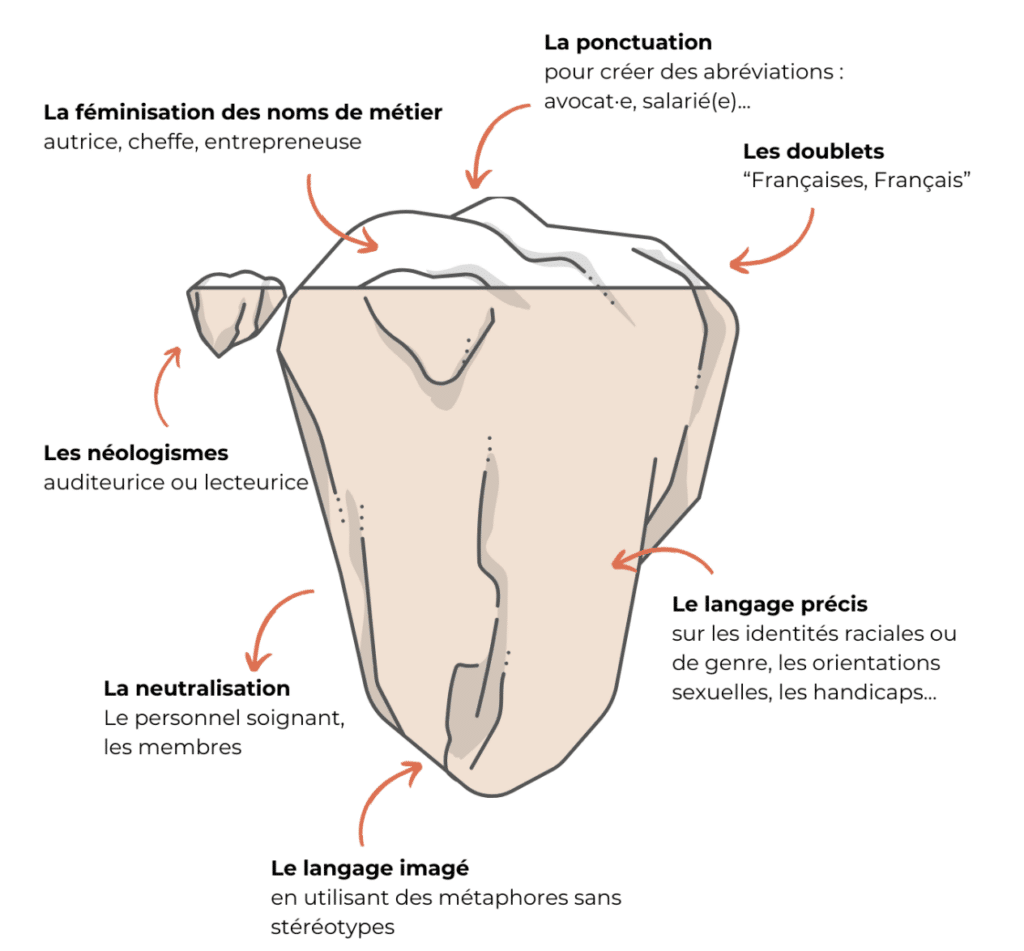Derrière ce titre un peu piège à clics, mon objectif est de prouver qu’on a beaucoup plus d’avantages à encourager la pratique du langage inclusif en entreprise qu’à ne pas le faire. J’emploie à dessein le terme de ROI, ou retour sur investissement, car je suis convaincue que ce mouvement vers un langage plus inclusif doit être lancé par tout le personnel de l’entreprise, mais que parmi les équipes de direction qui définissent les orientations stratégiques, la rentabilité, traduite par le ROI, reste un facteur déterminant de décision.
Si demain vous voulez donc convaincre votre chef·fe que le langage inclusif ce n’est pas seulement important mais aussi rentable, voici quelques arguments.
Les coûts du langage inclusif
La sensibilisation puis la formation des équipes (à tous les niveaux de l’entreprise)
Je me suis formée en 2h auprès de l’agence Mots-Clés sur la pratique de l’écriture inclusive pour 90 euros (format standard, il existe certainement d’autres formules). Je pense que le panel des formations disponibles doit continuer à s’étendre, et les entreprises vont avoir des besoins variées, allant de la sensibilisation de toutes les équipes, à la formation plus poussée de certains services ou personnes référent·es en interne (parlons-en ensemble si vous avez envie de lancer ces formations dans vos entreprises).
Les entreprises (en tout cas celles d’une certaine taille) ont de toute façon des budgets de formation à provisionner. Si vous avez déjà suivi une formation payée par votre entreprise qui ne servait à rien, vous savez qu’il y a sans doute là de l’argent à mieux investir.
Le temps des collaborateurs et collaboratrices
Le temps c’est de l’argent comme dit l’adage, aussi, on ne peut pas simplement faire comme si cela ne prenait pas du temps. Temps de se former, donc, mais aussi potentiellement temps des personnes qui en entreprise pourraient composer des comités de relecture inclusive, comme je le propose ici, c’est-à-dire des référent·es en langage inclusif ayant pour mission de relire les documents produits pour l’interne et pour l’externe afin de s’assurer d’éviter les formulations et les illustrations sexistes mais aussi de manière plus large homophobes, racistes, validistes…
La rédaction d’une charte du langage inclusif spécifique à l’entreprise (facultatif).
Cela peut être un bon moyen de transformer plus en profondeur l’entreprise, en ralliant tout le personnel autour de pratiques communément définies dans une charte, au même titre que le règlement intérieur ou la convention collective. Cette rédaction pourrait nécessiter l’accompagnement par des expert·es.
Cependant, les principes du langage inclusif sont en réalité assez simples, et même si une charte peut accélérer son adoption, elle n’est pas indispensable, aussi je ne la compte pas comme un coût forcé.
Je ne vois honnêtement pas d’autres coûts : pas besoin de logiciel, pas besoin d’embaucher des profils particuliers, pas besoin d’envoyer ses équipes se former très loin.
Les bénéfices du langage inclusif
L’impact sur la réduction des inégalités de genre
Vous allez me dire que ça, c’est très difficile à quantifier, et c’est vrai. Mais derrière cette idée, je veux surtout adresser une critique souvent faite au langage inclusif (et une des seules à mon sens qui mérite qu’on la discute, au même titre que la lisibilité et l’accessibilité de ce langage) : ça ne servirait à rien, et surtout pas à lutter contre le sexisme.
C’est un sujet très complexe et si vous avez un peu de temps, je vous recommande vraiment la lecture de cet article de Bunkerd, Ecriture inclusive : parlons faits et science, qui reprend les arguments et contre-arguments d’un point de vue scientifique et avec minutie.
En substance, les argument scientifiques, y compris des études et expérimentations comparant les niveaux de sexisme dans les différents pays en fonction de la langue parlée (toutes les langues ne traitent pas le masculin et féminin de la même manière, certaines ont un neutre…), montrent bien que oui, le langage contribue à forger nos représentations.
La médiatisation du débat sur l’écriture inclusive a été minée de caricatures et la science en a été la grande absente (…). Pourtant, la littérature scientifique apporte des éléments pertinents : oui, un langage inclusif a un impact et peut permettre notamment de réduire le rôle des stéréotypes de genre dans les aspirations professionnelles des un·e·s et des autres ; non, le masculin n’est pas si neutre dans sa pratique.
Article sur Bunkerd
Mon exemple préféré est l’étude qui a montré que parler constamment au masculin des noms de métiers, notamment quand on présente à des étudiantes des descriptifs de ces mêmes métiers, les fait moins se projeter dans ce métier que des formulations inclusives. En gros, à force de ne parler que de concepteurs-rédacteurs, les jeunes femmes ne se voient pas devenir conceptrices-rédactrices.
Evidemment, ce n’est pas uniquement en promouvant un langage inclusif que l’on mettra fin au sexisme, car le sexisme est l’un des éléments d’un système complexe, le patriarcat, qui lui-même est composé de nombreuses couches. Mais le langage est partout, tout le temps, alors l’ignorer ne peut que conduire à ralentir la chute du système de domination masculine.
Rendre concrets les engagement de l’entreprise en faveur de la diversité et de l’inclusion
On dit : actions speak louder than words (tiens, est-ce que j’aime bien cette expression finalement ?) et en matière d’engagement RSE des entreprises, c’est encore plus vrai. Créer un environnement de travail inclusif fait de plus en plus souvent partie des engagements des entreprises qui veulent promouvoir la diversité par leur recrutement et s’assurer la rétention de leur personnel par la mise en avant de valeurs inclusives.
Quoi de plus concret, immédiatement visible, facile à mettre en oeuvre, que la promotion d’un langage inclusif dans l’entreprise ?
Proposer des formations spécifiques, s’assurer que la communication de l’entreprise soit inclusive, que les dirigeant·es s’engagent sur ce sujet et en parlent, quoi de mieux pour rejaillir positivement sur la marque employeur ?
Au final, perte ou profit ?
Evidemment, je vais avoir du mal à conclure cette argumentation avec une formule mathématique, à l’image des bilans comptables. Mais je suis à peu près sûre que c’est peu couteux à mettre en oeuvre et que ça peut potentiellement rapporter gros.
Et je peux partager ma conviction : alors qu’on écrit dans le cadre professionnel des tonnes d’emails, de présentations et documents en tous genres, de messages de chat, le monde de l’entreprise est un terrain d’opportunités (que l’on soit salarié·e, dirigeant·e, indépendant·e, chef·fe d’entreprise…). On y a finalement le pouvoir de contribuer à une représentation plus juste du monde en choisissant et diffusant les mots justes, par la pratique d’une solution simple et peu coûteuse à mettre en oeuvre, le langage inclusif.