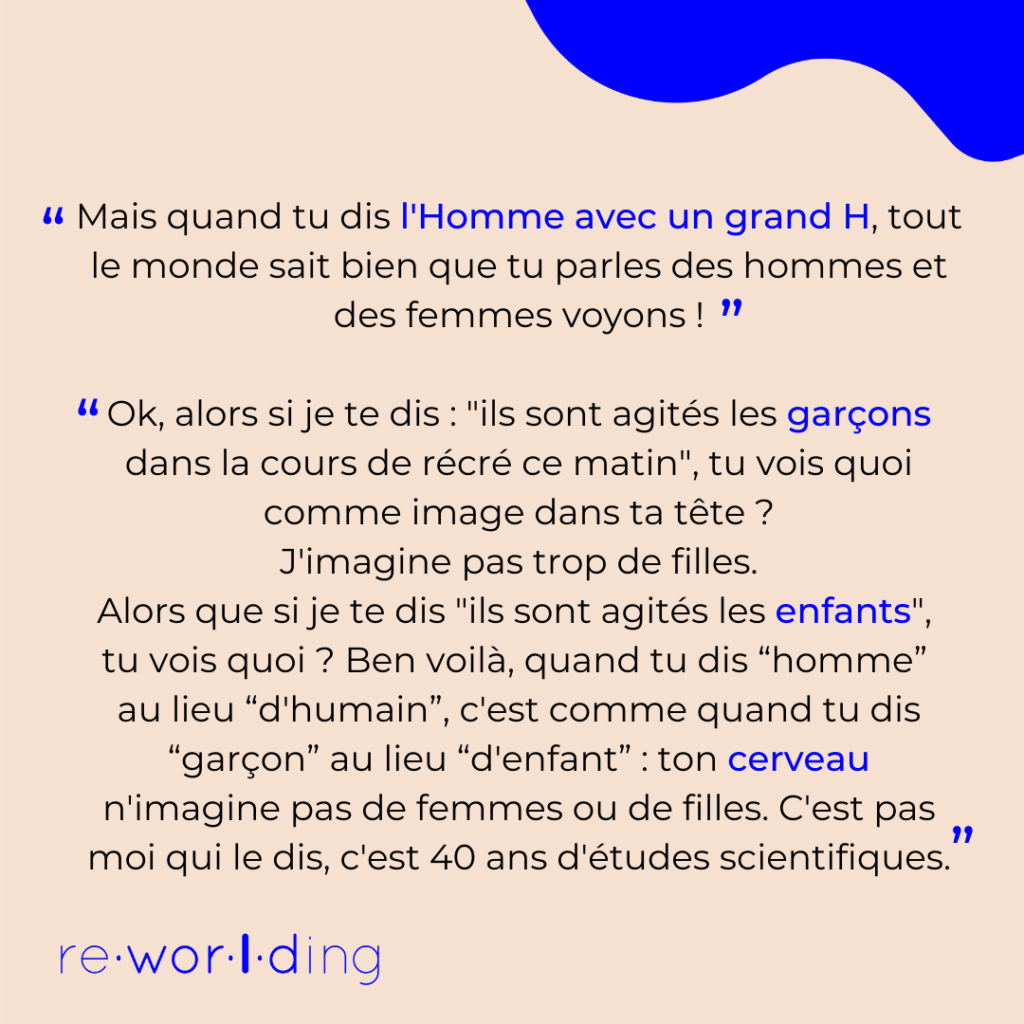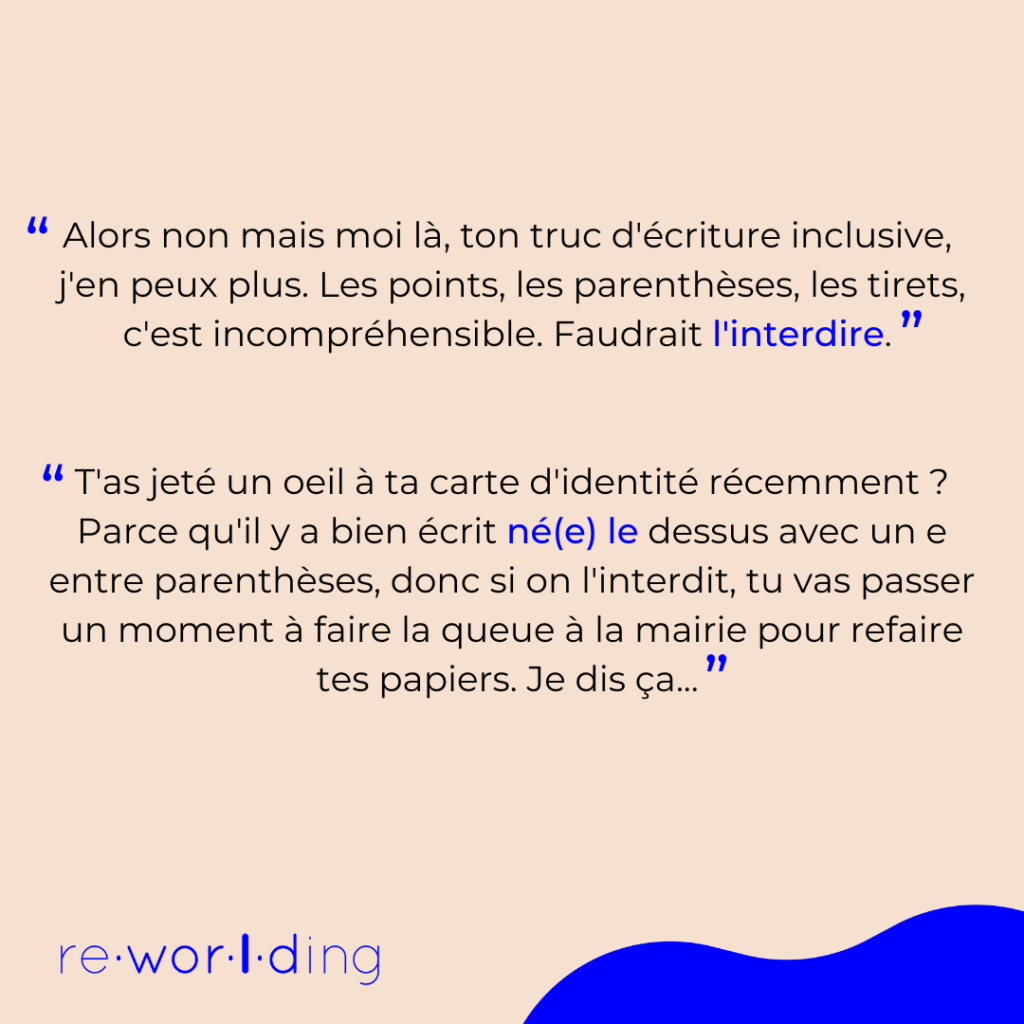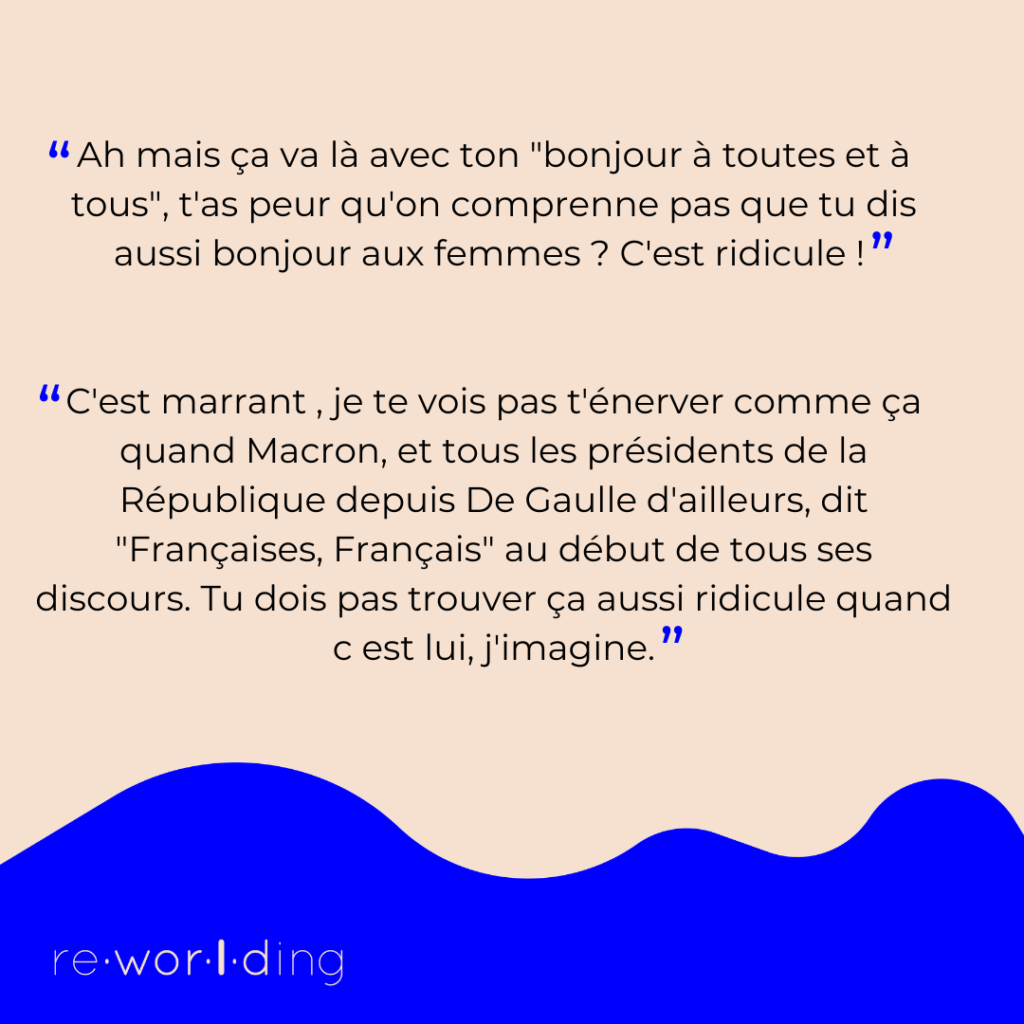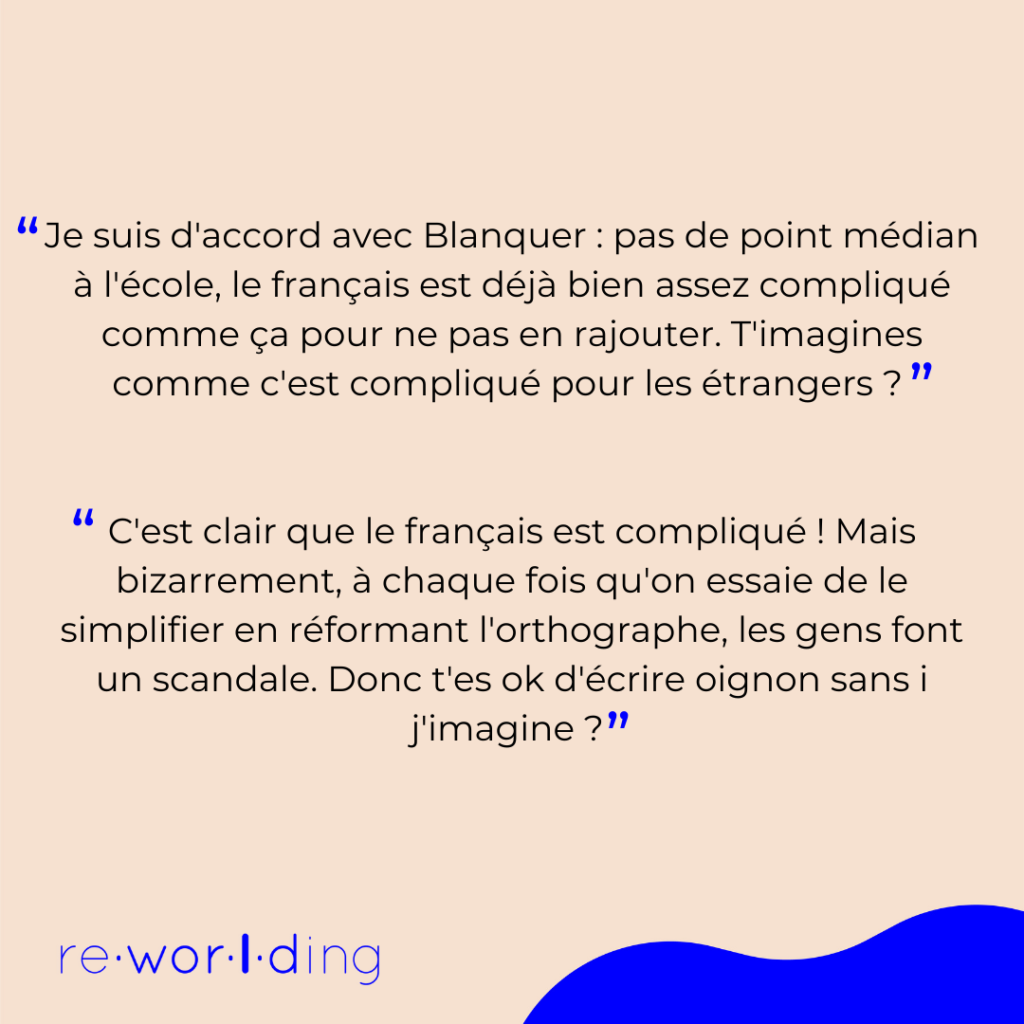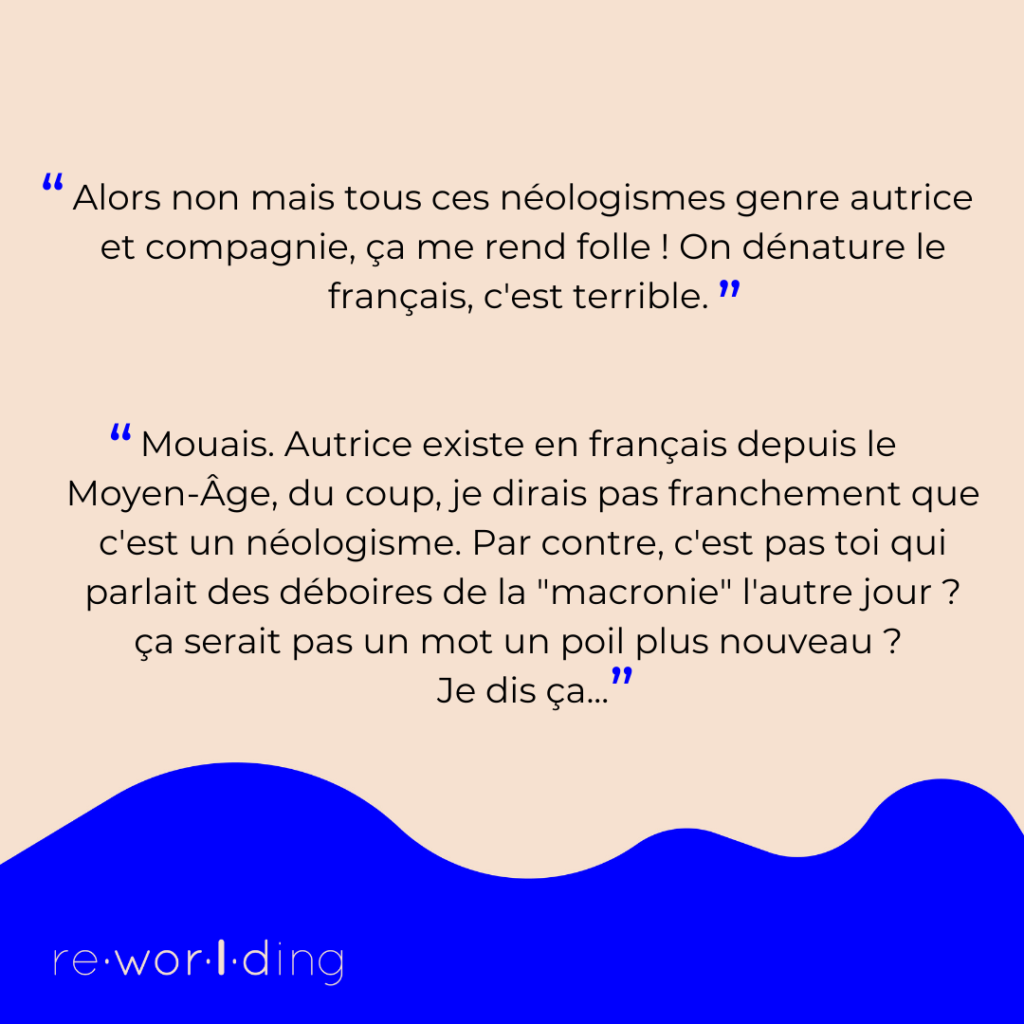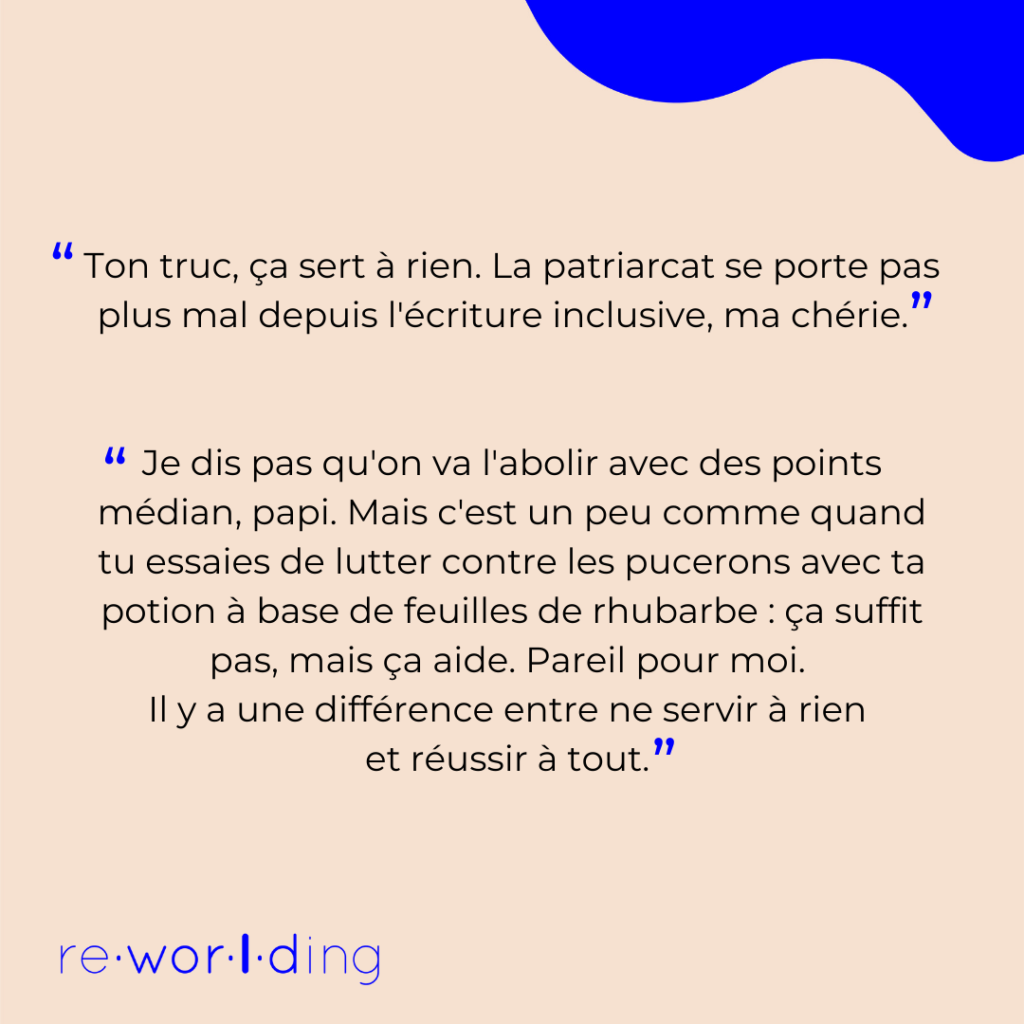En 2021, j’ai formé au langage inclusif environ 300 personnes dans mon entreprise (qui en compte environ un millier dans ses bureaux parisiens), et c’est un accomplissement dont je suis très fière. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de partager le contenu de cette formation (dans une version condensée et bien moins interactive) lors d’une journée spéciale organisée par les Ateliers numériques de Google que vous pouvez revoir sur YouTube.

Cependant, même si le taux de satisfaction de la formation était très élevé (avec une note de 4,7/5), j’ai observé dans mes interactions avec les personnes formées que finalement peu d’entre elles avaient développé une pratique systématique du langage inclusif et que l’écrasante majorité ne le pratiquait que très peu voire pas du tout. Il faut noter l’exception du service marketing de mon entreprise qui s’est emparé du sujet comme d’un objectif d’équipe et dont je détaille les actions dans l’article Le marketing inclusif passe aussi par le langage sur Thinkwithgoogle.fr.
Il semblait donc que j’étais confrontée à un paradoxe : alors que les feedbacks de cette formation montraient que les personnes ressortaient convaincues de la nécessité d’un langage plus inclusif, cette conviction ne se transformait pas (ou peu) en pratique.
Deux questions se posaient alors à moi : comment objectiver cette intuition pour s’assurer que ces observations représentaient la réalité ? Et si c’était bien le cas, comment mieux accompagner le passage de la conviction à la pratique ?
90% des personnes formées ont une pratique au moins occasionnelle du langage inclusif
A la fin de 2021, j’ai donc proposé à toutes les personnes formées de répondre à un rapide questionnaire et de participer à une session d’échanges et de retours d’expérience.
10% des personnes formées environ ont répondu au questionnaire : près de 90% des répondant·es déclarent avoir une pratique au moins occasionnelle d’une forme ou une autre de langage inclusif. Cela peut être simplement dire « bonjour à toutes et à tous » ou féminiser les noms des métiers. Je trouve ce chiffre très élevé et il me réjouit, mais je veux le prendre avec précaution car il est fort probable qu’il y a un biais positif du fait que les personnes qui ont pris le temps de répondre sont très certainement les personnes les plus intéressées (voire impliquées) sur la question du langage inclusif.
En revanche, j’ai retiré de l’analyse combinée des données quantitatives du questionnaire et des données qualitatives de la session d’échanges des enseignements autrement plus pertinents et actionnables.
Frein #1 : la systématisation
« Je le fais de temps en temps mais j’ai du mal à le faire tout le temps » démontre à quel point il est difficile de déconstruire des automatismes ancrés depuis notre enfance et que la pratique du langage inclusif implique une grande conscience de soi (et de ce qu’on dit) pour sortir du mode « pilote automatique » dans lequel on est quand on s’exprime. Cela implique de réfléchir à quelque chose à quoi on a perdu l’habitude de réfléchir.
« Certains automatismes comme « hey guys » restent en tête malgré une volonté d’être inclusif. Cela est probablement causé par un manque de langage inclusif dans le contenu audio-visuel que je consomme. »
Je trouve très pertinent ce constat qu’il existe un lien entre notre manière de nous exprimer et les styles d’expressions auxquels nous sommes exposé·es en lien avec le langage inclusif. Et c’est pourquoi il est fondamentale pour moi d’influencer autant que possible les entités créatrices de discours public, visible, comme les marques (qui font de la publicité), les médias (qui manient un langage à forte valeur prescriptive) et le monde du divertissement au sens large (édition, séries, cinéma…).
Frein #2 : la spontanéité
« C’est plus facile à l’écrit qu’à l’oral » est le deuxième constat qui a émergé. Pour les personnes qui ont la conscience des automatismes décrits ci-dessous vient la question de la compétence.
« J’ai le sentiment de plafonner aux applications « faciles » du quotidien, j’aimerais bien réussir à aller plus loin en repensant parfois complètement la façon de formuler des phrases pour qu’elles soient par nature inclusive (plutôt que de doubler à chaque fois un mot par exemple). »
Ce qui est en jeu ici est à la croisée de la connaissance des 3 grandes conventions du langage inclusif (en tout cas celles que je pratique) et du sentiment que s’exprimer de manière inclusive prend plus de temps et demande un effort, parfois considérable. Je ne peux pas nier que cet effort existe et qu’il prend du temps, temps dont on ne dispose pas toujours quand on est sous la pression d’une deadline ou qu’on répond rapidement sur un chat. Cela dit, il y a une manière simple de réduire le sentiment d’effort : l’entraînement. Et même s’il peut paraître évident que pour parler de manière inclusive comme pour apprendre une langue étrangère on doit s’entraîner, encore faut-il identifier quelles sont les formes et modalités d’entraînement qui sont adaptées à chaque individu, en fonction de son contexte, de son temps disponible, de son objectif. En mode stage intensif à la Wall Street English et/ou en mode gamification comme le propose l’application DuoLingo ?
Frein #3 : une forme d’insécurité linguistique
« Personne d’autre ne l’utilise dans mon entourage » est le troisième mais certainement le plus fort des 3 freins identifiés, qui rentre en résonance avec de nombreux témoignages : pratiquer un langage inclusif crée la peur du jugement et de l’isolement.
« J’appartiens à une minorité ethnique très stigmatisée dans les médias en ce moment et je fais très attention à ça et donc pour l’instant je n’utilise pas le langage inclusif dans mes écrits. Je commence juste à utiliser « bonjour à toutes et à tous » à l’oral. »
Le langage inclusif est perçu, je cite, comme un « acte militant » qu’on ne peut employer que quand on s’adresse à une « audience éduquée » sous peine de passer pour celle ou celui qui « donne des leçons », voire d’être accusé « d’hypocrisie » si on est un homme.
L’isolement est donc craint pour soi en tant que locuteur ou locutrice mais aussi pour les personnes à qui on s’adresse en créant un écart entre les sachant·es et les autres, les militant·es et les autres. Cette forme de mise à l’écart peut se rapprocher du phénomène d’othering où l’on met l’accent sur ce qui nous sépare plutôt que ce qui nous rapproche (par opposition au concept de bridging).
On a aussi peur de devoir se justifier, de rentrer dans un débat dont on craint de ne pas maîtriser tous les arguments et de ressortir ridiculisé·e parce qu’on n’a pas réussi à répondre à toutes les objections (dont vous pouvez retrouver quelques exemples et 10 punchlines pour y répondre ici).
La mention de l’origine ethnique ou du genre masculin du locuteur montre aussi la dimension intersectionnelle de la difficulté à pratiquer le langage inclusif.
Finalement, ce qui se joue ici peut tout à fait s’apparenter à une forme d‘insécurité linguistique.
L’insécurité linguistique peut être définie brièvement comme l’inconfort ressenti par une personne au cours d’un échange verbal, le plus souvent en situation de communication formelle, c’est-à-dire assujettie à une norme linguistique précise, correspondant à l’usage dominant. Cette notion commence à entrer dans l’usage commun car elle peut toucher tout un chacun se trouvant dans une situation de communication formelle où il est appelé à surveiller sa manière de parler.
Publictionnaire
Je vois un parallèle évident avec l’idée de surveiller sa manière de parler, d’avoir peur du jugement des autres si on ne s’exprime de la manière majoritaire, ainsi que dans l’inconfort lié au sentiment de ne pas maîtriser les conventions du langage inclusif et de « faire n’importe quoi ».
Comment sortir de cette insécurité linguistique ? Des pistes ont été évoquées par les répondant·es : s’appuyer sur sa position de leader dans une organisation ou un groupe pour inspirer l’expression générale ; créer, surtout dans le monde de l’entreprise, un cadre rassurant et protecteur pour les personnes qui veulent s’exprimer de manière inclusive (comme c’est le cas dans mon entreprise avec les guidelines des équipes marketing) ; surtout renforcer sa confiance en soi pour gérer l’inconfort et faire preuve de bienveillance envers soi-même et les autres pour minimiser le sentiment de mise à l’écart (othering) et créer des liens (bridging).
Comprendre ces freins permet maintenant de s’attarder à la deuxième question sur laquelle je réfléchis actuellement : comment mieux accompagner le passage de la conviction à la pratique ?
Une de mes pistes de réflexion est de m’inspirer des outils du coaching, une pratique bienveillante et sans jugement qui vise à rendre autonomes les individus à la poursuite d’un objectif (ici, ancrer la pratique du langage inclusif) en identifiant freins mais surtout ressources par le questionnement ouvert et la prise de conscience. Tout un programme, non ?
Nous verrons où me mèneront ces explorations mais je retiens en tout cas que ne pas pratiquer le langage inclusif, même quand on est convaincu·e de son utilité, va bien plus loin que de simplement « ne pas connaître les règles à appliquer » : c’est une parcours de déconstruction et reconstruction qui demande engagement, confiance et entraînement.