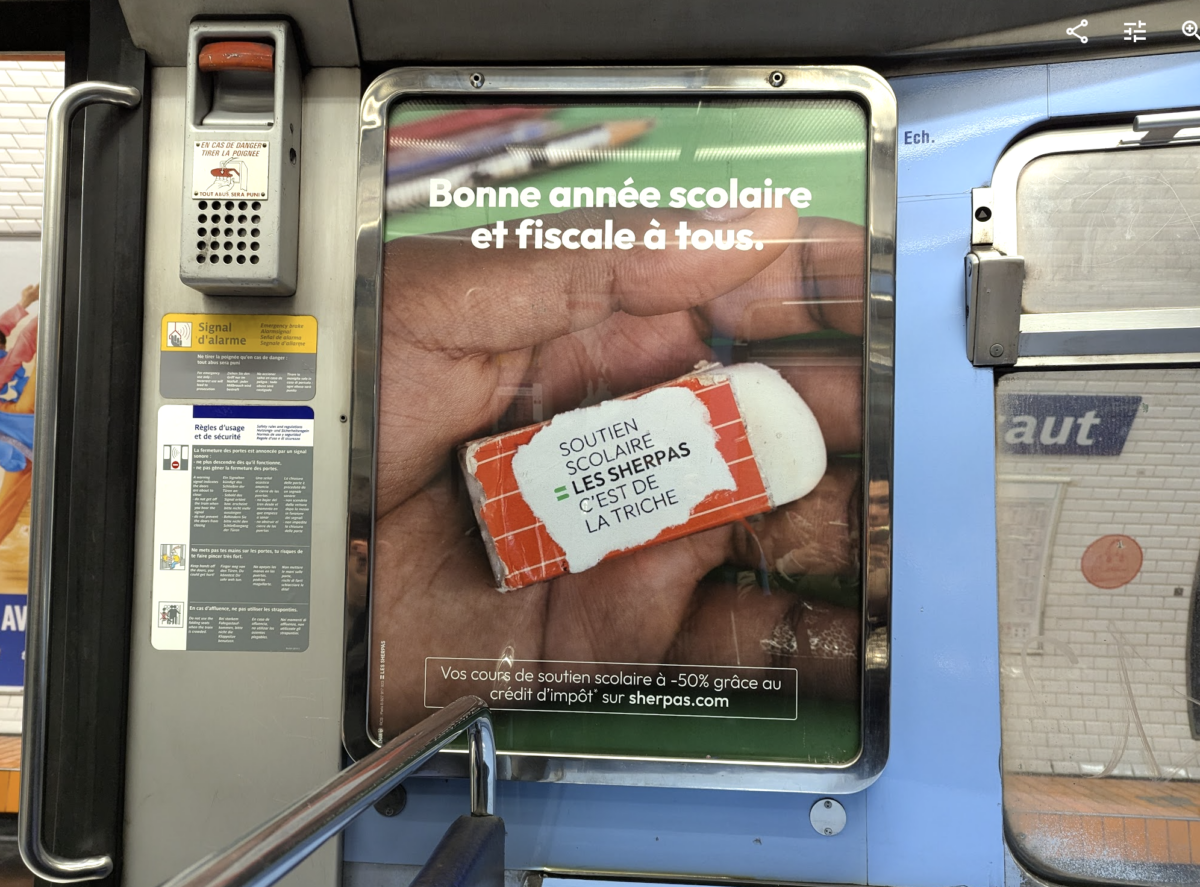Peut-on insulter en pratiquant un langage inclusif ?
N’y allons pas par quatre chemins : oui, mais ça va demander de faire quelques efforts, et non des moindres.
Insulter, c’est :
Proférer des paroles, avoir un comportement (interprétables comme) offensant quelqu’un par une attitude de dédain, de défi, de mépris.
CNRTL
Je peux penser à de nombreuses manières de montrer du dédain ou du mépris par l’insulte, que je profère allègrement, mais toujours loin des oreilles de ma progéniture.
L’insulte n’est pas seulement un mode d’expression, c’est aussi un moyen de soulagement, et on a par exemple montré qu’il est plus facile de résister à la douleur quand on profère des insultes que quand on s’en abstient.
Dans la pop culture, les films, séries, livres regorgent du cliché de la femme accouchant qui insulte la terre entière : ce portait ne véhicule donc pas uniquement le stéréotype de la femme hystérique, submergée par ses émotions et sa douleur, ici bien légitimes (et nous reviendrons sur le terme hystérique dans un prochain article), mais décrit une véritable technique pour essayer de les gérer au mieux.
Mais revenons au sujet du jour : « quelle conne », « connard de merde », « connasse » ont toujours été dans mon top 10. Mais aujourd’hui, j’essaie de changer et des les supprimer de mon vocabulaire. Pourquoi ?
Est-ce que ça vous viendrait à l’idée de traiter une personne de vulve ?
C’est pourtant ce que l’on fait quand on emploie le mot con ou conne comme une insulte. Car le mot con, à l’origine, désigne la vulve, c’est-à-dire la partie externe de l’appareil génital féminin. Et donc en réalité, à chaque fois qu’on traite quelqu’un·e de con·ne ou d’un de ses dérivés comme connasse ou connard, c’est par assimilation de la vulve à quelque chose de dégradant, méprisable, dédaignable. Même si cette insulte est très ancienne et que la plupart des gens qui la profèrent ont oublié ou n’ont même jamais su d’où elle vient, dans notre perspective de déconstruction des expressions sexistes, celle-ci est en bonne place.
Car traiter de con·ne, c’est donc vouloir offenser ou blesser en assimilant le corps d’une femme (par une de ses parties les plus distinctives) à quelque chose de méprisable. On va ici au-delà du sexisme (la discrimination par le sexe) pour rentrer en territoire clairement misogyne (le mépris des femmes).
D’ailleurs, je ne résiste pas à citer de nouveau un Académicien qui s’est beaucoup fait entendre sur la question de la féminisation des noms de métiers, et qui a eu cette sortie dont je vous laisse apprécier le niveau de misogynie de compétition.
Dans les vingt ou vingt-cinq dernières années, j’ai vu naître, devançant la commission, un petit nombre de féminins auxquels on ne pensait pas et dont on ne peut plus se passer. Ainsi, l’admirable substantif “conne”.
George Dumézil, Académicien, 1984
Mais alors, couillon·ne, c’est mieux ?
Remplacer l’un par l’autre ne me satisfait pas pour trois raisons : la première est que le sens n’est pas tout à fait le même. Là où con parle de bêtise, de stupidité, de sottise, bref de connerie, couillon porte une autre dimension, liée elle à l’assimilation des couilles au courage, car on sait bien que le coeur de la témérité se loge dans les bourses d’un homme. On ajoute donc à la dimension de bêtise celle de lâcheté. Le sens n’est pas le même, le remplacement de l’un par l’autre n’en a donc pas vraiment.
Ensuite, je trouve qu’il y a une certaine forme de mignonnerie à couillon, comme si on parlait d’une petite couille, qu’on peut dire avec une forme de tendresse. Dire « mais quelle con·ne » et « mais quelle couillon·ne », ça ne renvoie pas la même force insultante à mon oreille (et il en sera peut-être différemment pour vous).
Enfin, et c’est sans doute l’argument le plus important : ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’autrui te fasse à toi-même. Si je souhaite éviter l’usage du mot con·ne parce que je cherche à déconstruire cette expression en réalité misogyne, ça ne devrait pas être pour encourager à stigmatiser un organe masculin en le tournant en ridicule.
En alternative à con·ne ou couillon·ne, je vais personnellement tenter d’utiliser d’avantage bouffon·ne, raclure de merde ou de bidet (qui a l’avantage d’être épicène, c’est-à-dire non marqué en genre) ou même crétin·e que je trouve joliment désuet (correction : la crétinerie ayant été assimilée à une maladie, utiliser ce mot comme une insulte est validiste, je le retire donc de ma liste) . Quelques idées idées supplémentaires pour vous sur le génial compte Instagram C’est quoi cette insulte ?
Et si on se réappropriait le mot con·ne ?
Si le sujet des insultes vous intéresse, je devriez aimer la courte série Netflix The History of swear words dans laquelle j’ai appris le fun fact scientifique mentionné plus haut sur le pouvoir analgésique des insultes.
Si tous les épisodes ne se valent pas, je recommande tout de même ceux dédiés aux mots pussy (chatte) et bitch (chienne, salope), car on y aborde une notion intéressante : celle de la réappropriation ou récupération des insultes (reclaiming, en anglais) par les femmes qui s’appellent bitch ou pussy entre elles pour reprendre le pouvoir sur ces mots en théorie dégradants. Le contexte et surtout la situation de la personne qui emploie ces termes sont alors déterminants : un homme appelant une femme bitch est a priori toujours insultant, une femme appelant une autre femme bitch peut être de la réappropriation, notamment pratiquée par des chanteuses comme Cardi B ou Nicki Minaj.
Est-ce que con·ne pourrait être objet de réappropriation ? J’en doute, car contrairement à bitch ou pussy dont les significations originelles restent présentes à l’esprit et dans les mots, l’association con/vulve est très éloignée dans l’esprit de la plupart des gens, de la même manière que dire merde ne fait plus vraiment penser à des excréments. La banalité du mot con·ne et son caractère relativement inoffensif (par rapport à pute par exemple, déjà discuté ici) n’en font pas un bon candidat car il n’est même plus suffisamment offensant pour mériter d’être récupéré.
Voilà pourquoi je vais tenter de m’abstenir autant que possible de dire con ou conne. Et je vous le dis, c’est pas gagné.