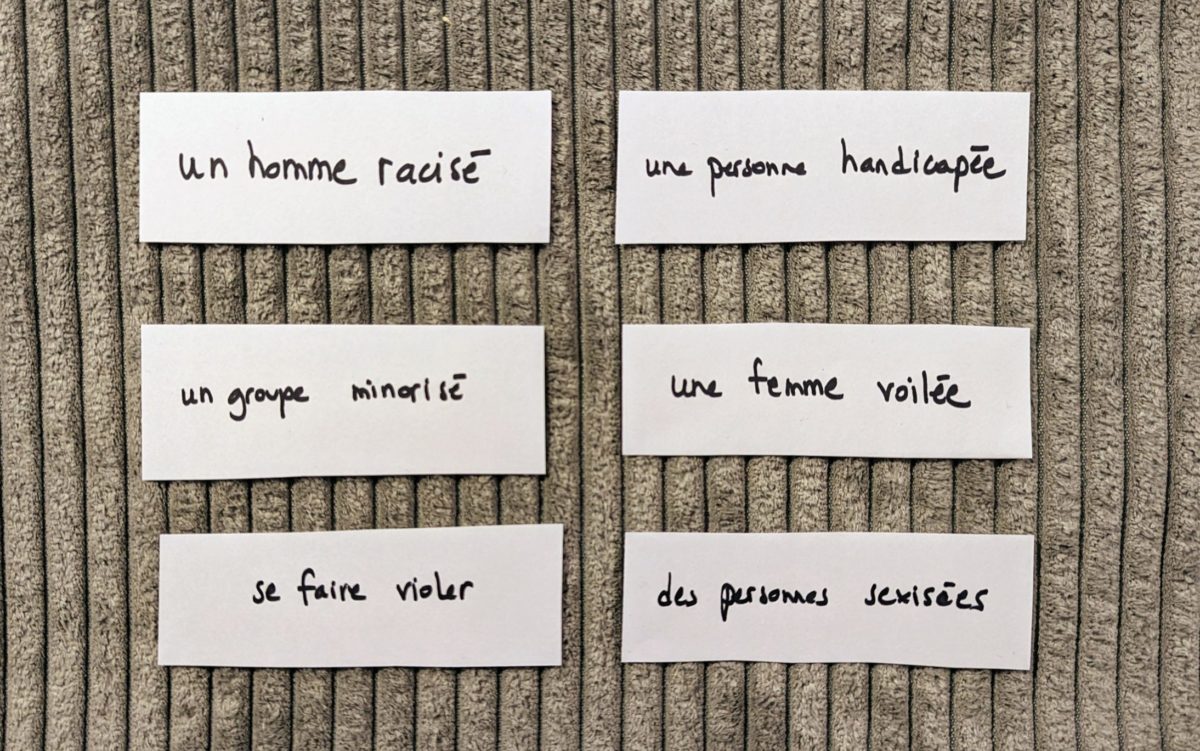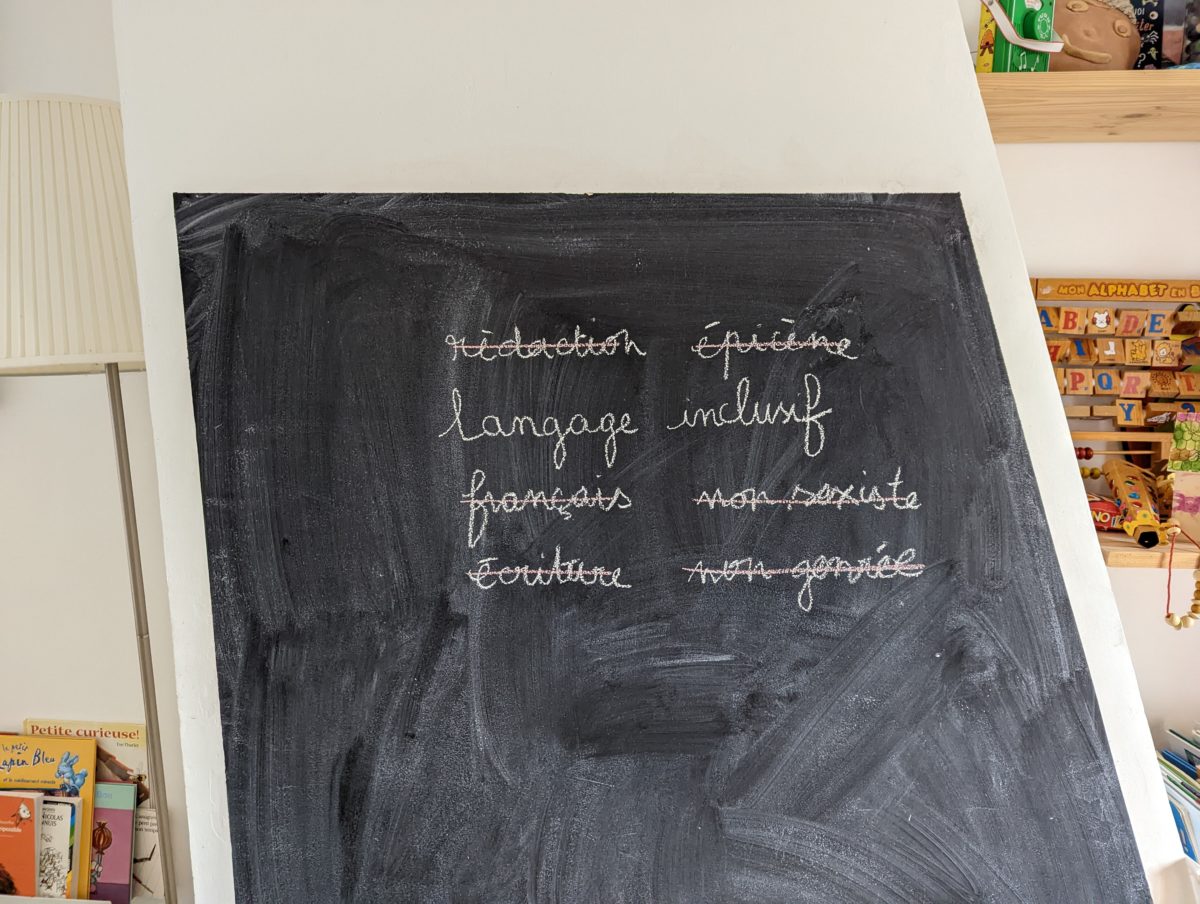C’est le 8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes et on sait qu’on va voir de nombreuses entreprises mettre avec fierté en avant leurs engagements pour l’égalité professionnelle. Certaines seront authentiques, d’autres moins. Certaines seront ambitieuses et mettront des millions sur la table. D’autres auront des actions symboliques pour ne pas […]